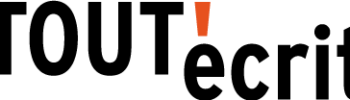Le native advertising est-il un gros mot ?
“Entre contenus journalistiques et contenus sponsorisés, où est la ligne jaune ?” Tel était le thème d’une conférence organisée par Sciences Po Paris, autour d’une pratique qui fait débat chez les professionnels de la presse. Instructif.
S’agit-il de l’émanation du bon vieux publi-rédactionnel adapté au digital grâce à la puissance de diffusion du Web ? S’apparente-t-il à du contenu journalistique payé par une marque ou n’est-il qu’un ersatz de publicité pure et dure ? Si chacun a sa propre définition du native advertising, l’IAB, qui a édité un Livre Blanc sur le sujet, en précise les contours, en écrivant qu’il est une “évolution d’un point de vue éditorial et une révolution par le moyen de distribution”. En cela, il donnerait “aux annonceurs une nouvelle clé pour engager le consommateur en offrant une opportunité de monétisation supplémentaire aux éditeurs”, selon la publication de l’Interactive Advertising Bureau.
« Être en cohérence avec nos valeurs éditoriales »
Si les marques entrevoient tous les bénéfices qu’elles peuvent tirer de cet OVNI éditorial, très proche du brand content, les patrons de presse, quant à eux, sont tiraillés par des problématiques d’ordre éthique et déontologique. Ils hésitent encore à se livrer à cette pratique apparue aux États-Unis en 2012, dans un contexte de fortes mutations technologiques. « Chez nous, les journalistes ne participent d’aucune manière à la production de ces contenus, ni à la mise en place de ces dispositifs qui sont gérés par notre service des opérations spéciales », se couvre Isabelle André, avec prudence.
La présidente du Monde interactif ajoute : « On ne créera pas une chaîne spécifique sur un thème précis pour répondre à la demande d’un annonceur ». « À L’Express, note Éric Mettout, directeur adjoint de la rédaction de l’hebdomadaire, il peut nous arriver de faire appel à pigiste pour traiter d’un sujet spécifique. Cela a été le cas lors d’une opération que nous avons menée avec Loewe. Les contenus ont été produits par un journaliste, sans que l’annonceur ne puisse les contrôler. Parfois, ils sont réalisés par la marque elle-même ou par une agence extérieure. Le seul impératif, pour nous, est que les campagnes soient en cohérence avec les valeurs éditoriales de notre journal ».
Autre obligation : que ces contenus sponsorisés soient clairement estampillés comme tels et « que le fléchage soit très clair pour le lecteur », précise Isabelle André. Un propos plein de bon sens, alors que la polémique enfle au sujet de Cyprien Iov, l’un des YouTubeurs les plus regardés de France. Sous contrat avec une agence de communication, le jeune homme est pointé du doigt pour avoir diffusé des vidéos pour le compte d’un éditeur de jeux, en dissimulant le fait que celles-ci étaient sponsorisées.
Des revenus additionnels pour les éditeurs
Mêlant publicité et contenus éditoriaux, le native advertising est un sujet passionnant car il nous interroge sur la conception que nous nous faisons du métier de journaliste et de notre rapport aux marques. La conférence de Sciences Po s’est ainsi ouverte avec l’exemple d’un contenu très riche traitant des conditions de détention des femmes en prison, et publié sur le site du New York Times.
On apprend que l’article est sponsorisé par Netflix pour promouvoir sa série “Orange is the new black”, libre adaptation des mémoires d’une jeune femme emprisonnée durant un an aux États-Unis. « Selon moi, c’est du journalisme. C’est un contenu de qualité que nous pourrions publier et qui ne me pose aucun problème car il ne vante pas les mérites de la plateforme de streaming vidéo », argumente Éric Mettout, en évoquant spécifiquement cet article.
« Les marques viennent chercher de l’audience »
Une chose semble acquise cependant : le native advertising peut constituer une source de diversification des revenus des éditeurs, sur fond de crispation du marché publicitaire. Si aucun des intervenants ne précise le montant des recettes générées en interne par ces opérations éditoriales “brandées”, on saura tout de même qu’elles peuvent atteindre plusieurs dizaines ou centaines de milliers d’euros. « C’est sûr que c’est plus rémunérateur que des pubs classiques », atteste Éric Mettout. « Ce sont des dispositifs lourds qui mobilisent beaucoup de temps, mais ce sont aussi des opérations à forte valeur ajoutée pour les annonceurs, qui viennent chercher de l’audience en bénéficiant de la puissance des marques médias », mentionne Stéphane Hauser, directeur général de l’IAB France, qui estime que l’acte de naissance du native advertising remonte à l’époque où Facebook a décidé d’intégrer ses publicités dans le flux.
Un ménage à trois : marques, éditeurs et agences
Toujours est-il qu’au-delà des questions d’éthique, les grands news magazines ou les quotidiens publient régulièrement des tirés-à-part thématiques sur des sujets tels que le vin, la mode ou encore le champagne, sans s’interroger sur le sexe des anges. « Il ne faut pas se raconter d’histoire : ces suppléments sont réalisés parce qu’il y a des annonceurs derrière. Avec une autre mécanique, il en va de même pour le native advertising », tranche Éric Mettout.
En tout cas, pour les agences de presse et les agences éditoriales, le native advertising constitue une opportunité d’accompagner les entreprises dans la production de contenus à forte valeur ajoutée et de délester les éditeurs des contraintes que cette “forme de journalisme” ne manque pas d’occasionner.